Il y a 20 ans s’ouvrait le procès de Maurice Papon
Pendant six mois, historiens, résistants, fils et filles de victimes, hommes politiques vont tenter d’établir le rôle de l’accusé et de Vichy dans l’arrestation puis la déportation de 1690 juifs à Bordeaux et sa région, entre 1942 et 1944.
De la remise en liberté de Papon aux plaidoiries, retour sur les principaux moments et témoignages du procés. Six mois de débats intenses, au terme desquels le haut fonctionnaire sera condamné à dix ans de réclusion criminelle.
L ‘affaire Papon
“L’affaire Papon” a éclaté le 6 mai 1981, entre les deux tours de l’élection présidentielle. Le Canard Enchaîné publiait ce jour-là un article intitulé :
Quand un ministre de Giscard faisait déporter des juifs.
L’hebdomadaire satirique publie ensuite les 13 et 20 mai 1981 des documents signés Papon, qui tendent à prouver sa responsabilité dans la déportation de 1690 juifs de Bordeaux à Drancy, et de-là vers Auschwitz, entre 1942 et 1944.

Papon, grand serviteur de l’Etat
La révélation qui vise le ministre du Budget de Valéry Giscard d’Estaing, est un coup de tonnerre.
Préfet, maire, député, ministre, Maurice Papon, grand serviteur de l’Etat, a connu durant des décennies les honneurs de la République.
Il est demeuré près de neuf années (1958-1967) à la tête de la Préfecture de police de Paris, en particulier durant la guerre d’Algérie. C’est lui le « patron » lors de la répression des manifestations d’Algériens le 17-20 octobre 1961 (des dizaines de morts) et de celle au métro Charonne, le 8 février 1962 (9 morts)
14 ans d’instruction
Une première plainte est déposée le 8 décembre 1981 pour “crimes contre l’humanité” au nom de la famille Matisson-Fogiel, concernant huit personnes, arrêtées et internées à Bordeaux et exterminées à Auschwitz.
Un Jury d’honneur composé d’anciens résistants rend cependant le 15 décembre une sentence plutôt favorable à Papon.
Il lui reproche d’avoir contribué à des arrestations et déportations, et de ne pas avoir démissionné en juillet 1942, mais conclut qu’il a participé à la Résistance par une attitude “courageuse”.
Après de nouvelles plaintes et l’ouverture d’une information judiciaire en juillet, Papon est inculpé en janvier 1983 de “crimes contre l’humanité”.
► Revoir la déclaration à la presse de Maurice Papon suite à son inculpation le 19 janvier 1983 à Bordeaux :
Bordeaux : déclaration de Maurice Papon en janvier 1983
► Revoir l’interview de Maurice Papon recueillie par Jean-Pierre Dinan le 15 janvier 1983 pour France 3 Aquitaine :
Si j’avais à refaire ce que j’ai fait, je le referai
Bordeaux : Interview de Maurice Papon au micro de Jean-Pierre Dinan le 15 janvier 1983.
La chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux est désignée pour reprendre l’affaire.
En 1988, nouvelle inculpation. Recevant à l’Elysée l’association Résistance-Vérité-Justice qui soutient Papon, le président François Mitterrand qualifie l’affaire de “règlement de comptes politique” et la longueur de l’instruction d'”attentatoire à la démocratie”.
En 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux renvoie Maurice Papon devant la cour d’assises pour complicité de crimes contre l’humanité, contre l’avis initial du procureur général.
Les temps forts
Le plus long procès criminel de l’après-guerre
► Revoir le reportage de Zinedine Boudaoud et Christian Gaudin sur la cérémonie orgnaisée par les parents de victimes de déportations la veille du procès de Maurice Papon le 7 octobre 1997 :
Bordeaux : cérémonie à Mérignac en mémoire des juifs déportés
La remise en liberté pour raison de santé
Maurice Papon, 87 ans, se constitue prisonnier la veille du procès. Dès l’ouverture, le procureur général Henri Desclaux annonce qu’il retient désormais l’intégralité des faits reprochés, dont la complicité d’assassinat, jusque-là exclue.
Le même jour, le principal avocat de Papon, Jean-Marc Varaut, demande sa remise en liberté. Il l’obtient le 10 octobre, pour raisons de santé, sous les protestations des parties civiles.
► Ecoutez les réactions des parties civiles lors de la remise en liberté de Maurice Papon le 10 octobre 1997. Reportage de Jean-François Meekel et Bernard Hosteins :
Bordeaux : procès Papon, réactions à sa remise en liberté
Papon, “persona non grata” dans les hôtels bordelais, est contraint de déménager à plusieurs reprises.
► Revoir le reportage de Philippe Denis et Pierre Dick sur la polémique autour de l’hérgement de Maurice Papon :
Papon, “persona non grata” dans les hôtels bordelais, est contraint de déménager à plusieurs reprises.
► Revoir le reportage de Philippe Denis et Pierre Dick sur la polémique autour de l’hérgement de Maurice Papon :
Bordeaux : procès Papon polémique hébergement
De grandes figures du gaullisme à la rescousse
L’accusé reçoit, dans les premiers jours du procès, l’appui de grandes figures du gaullisme, venus témoigner.
Ainsi, Philippe Séguin, ancien président de l’Assemblée nationale, dénonce ce procès comme un prétexte à faire “celui du général De Gaulle et celui de la France”.
L’ex-Premier ministre Pierre Messmer prône le pardon et exonère Papon de toute responsabilité dans la répression de manifestations liées à la guerre d’Algérie, en octobre 1961, alors qu’il était préfet de police. C’est un “procès dans le procès”, dit-il.
► Revoir le reportage de Jean-François Meekel et Bernard Hosteins sur le témoignage à décharge de l’ex-Premier ministre Pierre Messmer :
Bordeaux : procès Papon soutien de l’ex-Premier ministre Pierre Messmer
Bataille d’historiens
Lorsque la parole est ensuite donnée aux historiens, s’opposent l’Américain Robert Paxton et le Français Henri Amouroux.
Le premier insiste sur la responsabilité des autorités françaises. “Sans l’aide de la police française, les Allemands n’auraient pu repérer les juifs et les arrêter”, dit-il.
Pour Henri Amouroux en revanche, “on ne peut pas écrire l’histoire en noir et blanc”.
A l’historien Jean-Pierre Azéma, selon qui “nul n’était obligé d’aller contre sa conscience”, Maurice Papon réplique: “Je n’ai pas démissionné car je voulais rester sur le champ de bataille”.
► Revoir le reportage de Jean-François Meekel sur le témoignage des historiens lors du procès :
Bordeaux : témoignages des historiens Robert Paxton et Henri Amouroux lors du procès Papon
► Revoir les témoignages de Jean Pierre-Bloch, ancien résistant et homme politique, et de Samuel Pisar, écrivain et survivant de la Shoah :
Bordeaux: interviews de Jean Pierre-Bloch et Samuel Pisar au procès Papon 1997
Le 10 janvier 1944, près de 400 juifs de Bordeaux, Libourne, Arcachon et Bayonne sont enfermés dans la Grande Synagogue de Bordeaux, transormée en prison.
Ils seront déportés à Drancy puis à Auschwitz.

Des témoignages poignants
La cour d’assises de Bordeaux entend ensuite les témoignages, souvent poignants, de parents de victimes dont on projette les photos sur grand écran.


Nous sommes des survivants, nous espérons de ce procès d’être des vivants
lance Maurice Matisson, dont huit proches ont été déportés dans un convoi organisé par Maurice Papon.
► Revoir le reportage de Jean-François Meeckel et Bernard Hosteins réalisé lors du procès en décembre 1997 :
Bordeaux: Extrait reportage sur les victimes de Maurice Papon
“Ces évènements d’il y a 50 ans, je n’ai jamais pu les oublier, j’ai vécu avec, c’est une plaie qui ne peut pas se refermer”, dit Hersz Librach, dont le cousin, Léon Librach, a été déporté de Bordeaux en 1942.
Je veux bien me repentir, mais de quoi ? De quelle faute ? J’ai eu des insuffisances, des maladresses, j’ai eu des échecs comme un vrai combattant
déclare l’accusé.
► Revoir le reportage sur les parents de juifs arrêtés à Bordeaux et déportés à Auschwitz :
Bordeaux : procès Papon témoignages des enfants de déportés
Le verdict
Le 9 mars, commencent les plaidoiries des parties civiles. Me Alain Jakubowicz réclame la perpétuité. Me Arno Klarsfeld soutient que Papon n’a pas eu de volonté meurtrière et que la peine doit être moindre.
Les 18 et 19 mars, le procureur général Henri Desclaux et l’avocat général Marc Robert requièrent 20 ans de réclusion.
Les avocats de la défense, Mes Marcel Rouxel, Francis Vuillemin et Jean-Marc Varaut réclament l’acquittement.
Le procès est interrompu durant trois jours par le décès de Mme Papon.
► Revoir le compte rendu d’audience lors de la plaidoirie de Me Jean-Marc Varaut :
Bordeaux: procès Papon plaidoirie de la défense Me Jean-Marc Varaut
Le 2 avril au matin, après une nuit blanche et dix-neuf heures de délibéré, le verdict tombe : dix ans de réclusion criminelle et la privation des droits civils, civiques et de famille.
► Revoir le reportage de Vincent Calcagni et Jean-Pierre Darot sur le verdict :
Bordeaux : verdict procès Papon le 2 avril 1998
Le 3 avril, en audience civile, Maurice Papon est condamné à verser environ 4,6 MF.
Le 21 octobre 1999, la Cour de cassation refuse d’examiner son pourvoi parce qu’il s’est enfui en Suisse au lieu de se constituer prisonnier la veille de l’audience. La condamnation devient définitive.
Maurice Papon est arrêté, extradé de suisse le jour-même et interné à Fresnes (Val-de-Marne).
En 2000, le président Jacques Chirac rejette les demandes de grâce médicale.
La justice le remettra en liberté le 18 septembre 2002 en raison de son état de santé. Il meurt le 17 janvier 2007.

Un procès historique
Le procès de Maurice Papon appartient déjà à l’Histoire. Et l’histoire retiendra que l’ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde a été condamnée pour complicité de crimes contre l’humanité au terme de six mois d’audience. Et rien n’était écrit d’avance…
Pour Me Gérard Boulanger, l’avocat qui déposa les toutes premières plaintes de l’affaire Papon, où il défendit 27 parties civiles, considère que ce procès a bénéficié “d’une fenêtre de tir ” historique unique”.
Ce procès était inenvisageable plus tôt sans une prise de conscience suscitée par les procédures Barbie et Touvier, il était impossible plus tard, estime l’avocat bordelais qui a consacré 17 ans de sa vie et trois livres à l’affaire.
C’est le procès d’un crime de bureau, d’un tueur stylographique, le seul de ce genre en France sur des crimes contre l’humanité
selon Me Gérard Boulanger interrogé le 29 septembre 2017 par nos confrères de l’AFP.
20 ans après le procès, la plupart des acteurs du procès sont décédés, notamment Michel Slitinsky, sans lequel le procès n’aurait pas pu avoir lieu.
La revue de presse du verdict du procès Papon
Que reste-t-il, 20 ans après du procès Papon ?
A cette question, Me Boulanger répond :
Sur le leg, j’avais plaidé à l’époque qu’après le verdict, l’Histoire de France ne serait plus la même. Cela a pu être le cas après coup, aujourd’hui je ne suis pas si sûr.
Car depuis, même s’il reste de la mémoire, on vit une drôle d’époque où un évèvement chasse l’autre. et je serais curieux de voir une enquête sur “Qu’évoque pour vous le nom de Papon ?” J’aurais peur d’être déçu”.
► Revoir le reportage de Guillaume Decaix sur le procès Papon, 20 ans après :
Bordeaux : procès Papon, 20 ans après






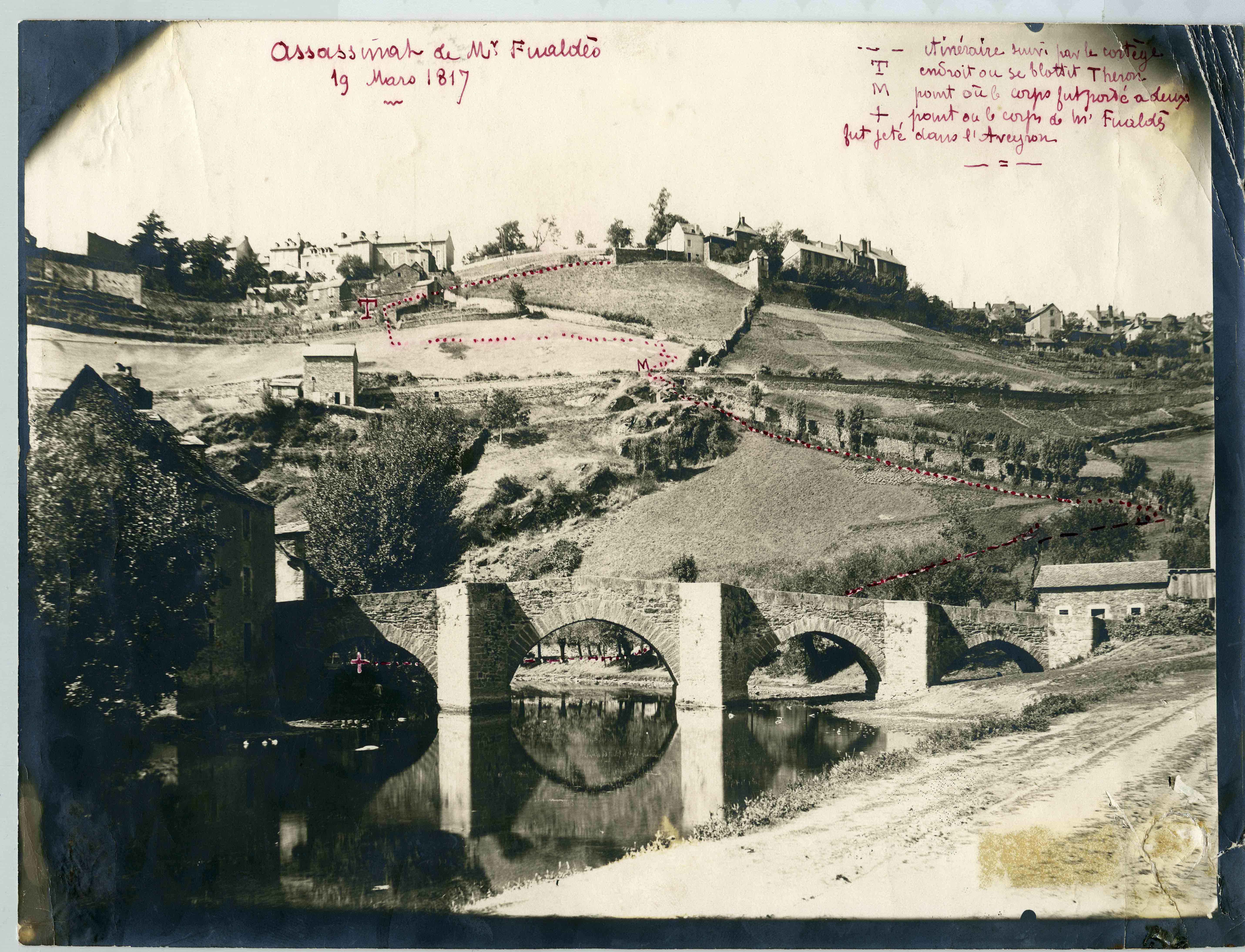




 768px,(min-width: 501px) 600px,(min-width: 401px) 500px,(min-width: 301px) 400px,(min-width: 1px) 300px” srcset=”//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/300×200/0c15/300d169/none/17545/JFHE/image_content_95233569_20170319174347.jpg 300w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/384×256/0c20/384d216/none/17545/JFGL/image_content_95233569_20170319174347.jpg 384w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/512×341/0c27/512d288/none/17545/JFPF/image_content_95233569_20170319174347.jpg 512w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/640×427/0c34/640d360/none/17545/JFOG/image_content_95233569_20170319174347.jpg 640w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/768×512/0c40/768d432/none/17545/JFGK/image_content_95233569_20170319174347.jpg 768w” alt=”Assassinat du procureur Fualdès : deux siècles de sang et d’encre” width=”768″ height=”432″ data-srcset=”//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/300×200/0c15/300d169/none/17545/JFHE/image_content_95233569_20170319174347.jpg 300w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/384×256/0c20/384d216/none/17545/JFGL/image_content_95233569_20170319174347.jpg 384w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/512×341/0c27/512d288/none/17545/JFPF/image_content_95233569_20170319174347.jpg 512w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/640×427/0c34/640d360/none/17545/JFOG/image_content_95233569_20170319174347.jpg 640w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/768×512/0c40/768d432/none/17545/JFGK/image_content_95233569_20170319174347.jpg 768w” /></div>
<div class=)

 http://fr.rian.ru/
http://fr.rian.ru/