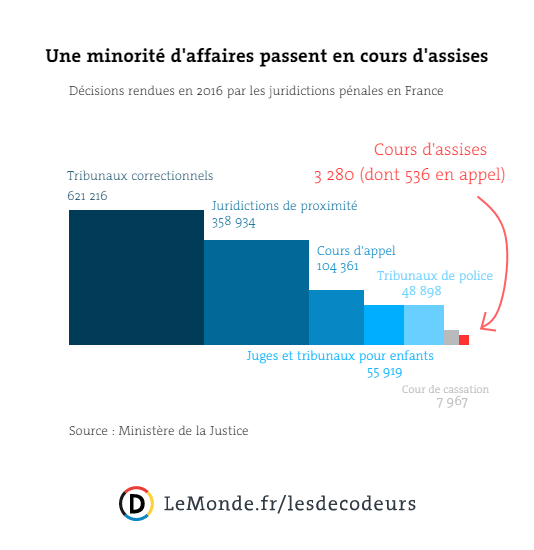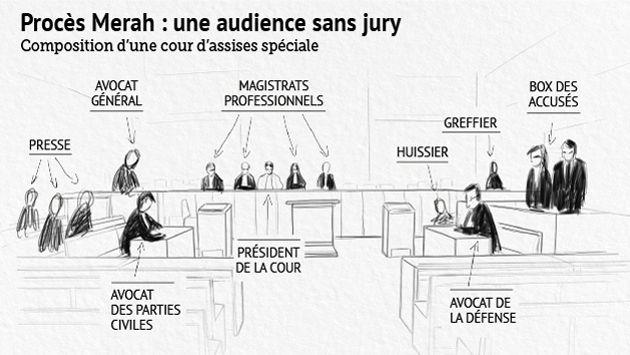En cas de condamnation par la cour d’assises, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé ; mais en l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent.
Crim. 8 févr. 2017, FS-P+B+I, n° 15-86.914
Crim. 8 févr. 2017, FS-P+B+I, n° 16-80.389
Crim. 8 févr. 2017, FS-P+B+I, n° 16-80.391
Par trois arrêts du 8 février 2017, la chambre criminelle a affirmé que, selon l’article 365-1 du code de procédure pénale, « en cas de condamnation par une cour d’assises, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé » et elle a ajouté « qu’en l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent dans les conditions définies à l’article 362 » du même code. Elle a, sur le fondement de ce principe, cassé pour violation de la loi les arrêts d’assises qui lui étaient soumis en ce qu’ils avaient motivé la peine prononcée. En d’autres termes, la chambre criminelle affirme que, si les cours d’assises doivent motiver la déclaration de culpabilité, elles ont l’interdiction, à peine de nullité, de motiver la peine prononcée, la présence d’une motivation de la peine, aussi succincte soit-elle, constituant un motif de cassation. Ces décisions appellent deux séries d’observations, tenant à la motivation des arrêts d’assises et à la cassation des arrêts en cause.
La motivation des arrêts d’assises a été instaurée par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, à la suite des positions exprimées par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Le Conseil constitutionnel n’avait vu aucune contrariété à la Constitution dans l’absence de motivation des arrêts d’assises (Cons. const., 1er avr. 2011, n° 2011-113/115 QPC, Dalloz actualité, 5 avr. 2011, obs. S. Lavric ; D. 2011. 1154, point de vue W. Mastor et B. de Lamy ; ibid. 1156, point de vue J.-B. Perrier ; ibid. 1158, chron. M. Huyette ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; AJ pénal 2011. 243, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2011. 361, obs. A. Cappello ; RSC 2011. 423, obs. J. Danet ). En revanche, la CEDH avait critiqué cette absence de motivation, qui est contraire au droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme lorsque les questions posées combinées avec l’acte d’accusation ne permettent pas de comprendre les raisons ayant conduit à la condamnation (CEDH 16 nov. 2010, Taxquet c. Belgique, n° 926/05 ; Dalloz actualité, 25 nov. 2010, obs. O. Bachelet ; D. 2011. 47, obs. O. Bachelet , note J.-F. Renucci ; ibid. 48, note J. Pradel ; Just. & cass. 2011. 241, étude C. Mathon ; AJ pénal 2011. 35, obs. C. Renaud-Duparc ; RSC 2011. 214, obs. J.-P. Marguénaud ). Il n’était pas en soi nécessaire de prévoir une motivation explicite des arrêts d’assises : si les questions sont suffisamment précises et nombreuses pour comprendre les raisons ayant conduit à la condamnation, il n’y a pas violation de l’article 6 de la Convention européenne (CEDH 10 janv. 2013, Légillon c. France, n° 53406/10, D. 2013. 615 , note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2013. 336, note C. Renaud-Duparc ). Le législateur a cependant préféré prévoir une motivation plus explicite qui doit être rédigée par le président ou l’un des magistrats assesseurs en cas de condamnation et qui consiste « dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions » (C. pr. pén., art. 365-1). La Cour de cassation exerce ainsi un contrôle de la motivation des arrêts d’assises d’appel frappés de pourvoi et n’hésite pas à casser l’arrêt lorsque la motivation sur la déclaration de culpabilité est insuffisante ou contradictoire (Crim. 20 nov. 2013, n° 12-86.630, Bull. crim. n° 234 ; Dalloz actualité, 5 déc. 2013, obs. S. Fucini ; D. 2013. 2779 ; AJ pénal 2014. 81, obs. P. de Combles de Nayves ; Dr. pénal 2014. Comm. 13, obs. A. Maron et M. Haas ; 16 déc. 2015, n° 15-81.160, Dalloz actualité, 21 janv. 2016, obs. J. Gallois ; AJ pénal 2016. 209 ; 16 nov. 2016, n° 15-86.106, Dalloz actualité, 6 déc. 2016, obs. L. Priou-Alibert ).
Seule la déclaration de culpabilité doit être motivée et la loi n’impose pas la motivation de la peine prononcée. En 2013, la Cour de cassation a refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point, en affirmant que « l’absence de motivation des peines de réclusion criminelle et d’emprisonnement prononcées par les cours d’assises, qui s’explique par l’exigence d’un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte au droit à l’égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les personnes accusées de crime devant les cours d’assises étant ainsi dans une situation différente de celles poursuivies devant le tribunal correctionnel » (Crim. 29 mai 2013, n° 12-86.630, préc.). Une telle motivation était assez contestable dans la mesure où l’exigence d’une motivation de la déclaration de culpabilité enlevait toute pertinence à l’argument du jury pour justifier l’absence de motivation de la peine. Le contraste entre la motivation en matière criminelle et celle en matière correctionnelle est saisissant : d’une part, en matière correctionnelle, le tribunal doit spécialement motiver le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis (C. pén., art. 132-19, al. 2). D’autre part, à la suite de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, l’article 132-1, alinéa 2, du code pénal précise que « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée », l’alinéa suivant ajoutant que, « dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 ». Dans une série d’arrêts récents, la chambre criminelle en a déduit que, contrairement à sa jurisprudence antérieure, toutes les peines, tant principales que complémentaires, doivent être motivées par référence aux éléments mentionnés par l’article 132-1 du code pénal (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. C. Fonteix ; 1er févr. 2017, n° 15-85.199, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. S. Fucini ; 1er févr. 2017, n° 15-84.511, Dalloz actualité, 15 févr. 2017, obs. S. Lavric ). Ainsi, alors que le législateur va vers l’exigence d’une plus grande motivation des peines en matière correctionnelle, que la Cour de cassation exerce un contrôle de la motivation et que la cassation est encourue si un arrêt en matière correctionnelle ne motive pas la moindre peine complémentaire par référence aux éléments de l’article 132-1 du code pénal, le prononcé d’une peine criminelle n’a pas à être motivé.
Le fait que la loi n’exige pas des cours d’assises la motivation de la peine prononcée n’est pas véritablement contestable. Si l’article 132-1 du code pénal affirme en termes généraux que « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée », l’article 365-1 du code de procédure pénale affirme de manière très précise que la motivation des arrêts d’assises ne porte que sur « les principaux éléments qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises ». Si l’absence de motivation de la peine en matière criminelle est critiquable compte tenu du mouvement constaté en matière correctionnelle, elle résulte de l’intention clairement exprimée par le législateur.
Mais une autre chose est davantage contestable dans les arrêts commentés : la chambre criminelle casse et annule les arrêts qui lui étaient déférés, en ce qu’ils contenaient des éléments portant sur la motivation de la peine. Elle vise pour ce faire, outre l’article 365-1, l’article 591 du code de procédure pénale : autrement dit, la chambre criminelle casse et annule ces arrêts pour violation de la loi. Le seul fait, par exemple, que la feuille de motivation contienne la phrase « l’absence de remise en cause de l’accusé n’est pas apparue comme un gage de réadaptabilité » entraîne la cassation de l’arrêt, malgré la présence par ailleurs d’une motivation quant à la culpabilité. On peut en effet s’en étonner car la Cour de cassation ne se contente pas de dire que la motivation de la peine n’est pas exigée : elle va jusqu’à interdire une telle motivation. Elle avait d’ailleurs déjà procédé de la sorte avant la création de l’article 365-1 du code de procédure pénale, lorsque l’arrêt d’assises contenait des énonciations relatives à la culpabilité ou à la peine prononcée autres que les réponses aux questions posées (Crim. 15 déc. 1999, nos 99-83.910 et 99-84.099, Bull. crim. nos 307 et 308 ; D. 2000. 50 ). Pourtant, cette motivation aurait pu être analysée comme un motif surabondant, c’est-à-dire un motif inutile « qui n’est pas nécessaire pour soutenir le dispositif de la décision, parce que celle-ci comporte d’autres motifs qui suffisent à la justifier (J. Boré et L. Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz Action, n° 113.11). Cela aurait conduit la chambre criminelle à rejeter les pourvois en l’absence d’autres motifs de cassation, l’article 365-1 du code de procédure pénale ayant été respecté dès lors que la motivation contient, à tout le moins, les éléments qui ont convaincu la cour de la culpabilité. D’ailleurs, aucun des demandeurs au pourvoi, dans les trois arrêts commentés, n’avait soulevé cet argument : ils contestaient la motivation quant aux prétendues insuffisances ou contradictions qu’elle contenait quant à la culpabilité. Ne pas exiger la motivation de la peine en matière criminelle est une chose ; l’interdire et casser l’arrêt d’assises qui y procède en est une autre, la Cour de cassation exprimant par là qu’une motivation de la peine prononcée en matière criminelle est une cause de nullité. Les conséquences à tirer de ces arrêts sont claires : le président ou l’assesseur qui rédige la feuille de motivation a interdiction, à peine de nullité, d’énoncer le moindre élément de motivation concernant la peine prononcée. Cette jurisprudence doit cependant conduire à une réflexion plus profonde sur l’éventuelle opportunité d’élargir la motivation des arrêts d’assises à la peine prononcée, motivation qui est matériellement possible malgré la présence d’un jury comme l’est devenue celle portant sur la culpabilité.
Site de la Cour de cassation
par Sébastien Fucini